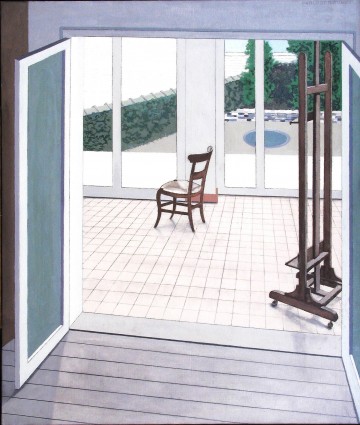La poésie est une respiration. Je n’ai pas dit une pause. Encore moins une pose – la poésie est sans affectation. Sur la page, le poème prend la place qu’il veut, il l’occupe comme lui seul peut le dire. Il ouvre un autre temps, il ne suit pas l’actualité. L’éternité ? Peut-être.
Francis Dannemark a publié en 2005, « comme une boîte de chocolats, sans explication ni mode d’emploi », un recueil de poèmes belges sous le beau titre
Ici on parle flamand & français : « J’ai voulu rassembler ici un petit nombre de poèmes (et quelques aphorismes) parmi tous ceux qui ont été composés depuis un siècle dans le pays où je suis né et où je vis encore aujourd’hui. C’est un petit pays à la frontière de deux mondes (on dit deux pour faire simple, en réalité ils sont bien plus nombreux) et l’on y parle principalement le flamand et le français. » Dans une même anthologie en langue française se côtoient deux univers linguistiques, par la grâce de la traduction et de l’esperluette.
Des poètes connus, méconnus. J’y ai glissé tant de signets qu’il m’est difficile de choisir. En citer plusieurs ? C’est tentant, mais non. J'écarte aujourd’hui les plus joyeux, les plus tristes. A chacun sa page, son heure, son jour – ou sa nuit. Place à Leonard Nolens (un Anversois né en 1947), traduit par Marnix Vincent.
Vermoeidheid / Lassitude
Quand nous, les grandes personnes, sommes las
De causer les uns avec les autres,
Quand nous sommes las de dormir
Les uns avec les autres, de nous promener
Et de commercer les uns avec les autres,
De dîner et de guerroyer
Les uns avec les autres, quand nous sommes si las
Les uns des autres, de toute cette réciproquerie
Des uns et des autres, alors nous posons le chat
Sur notre épaule, entrons dans le jardin
Et cherchons les voix enfantines derrière
Les hautes haies et dans la cabane de l’arbre.
Et silencieux, nous couchons notre lassitude
Dans l’herbe, et les années qui, lourdes
Et sombres, dormaient dans l’ourlet
De notre manteau se dénudent là-haut
Dans un gosier de gamin et dansent en
Sautillant dans une bouche humide de fillette.
Quand nous, les grandes personnes, sommes las
De causer,
De causer,
De causer les uns avec les autres,
Nous entrons dans le jardin et nous nous passons sous silence
Dans le chat, dans l’herbe, dans l’enfant.
(Laat alle deuren op een kier / Laissez toutes les portes entrouvertes, 2004)